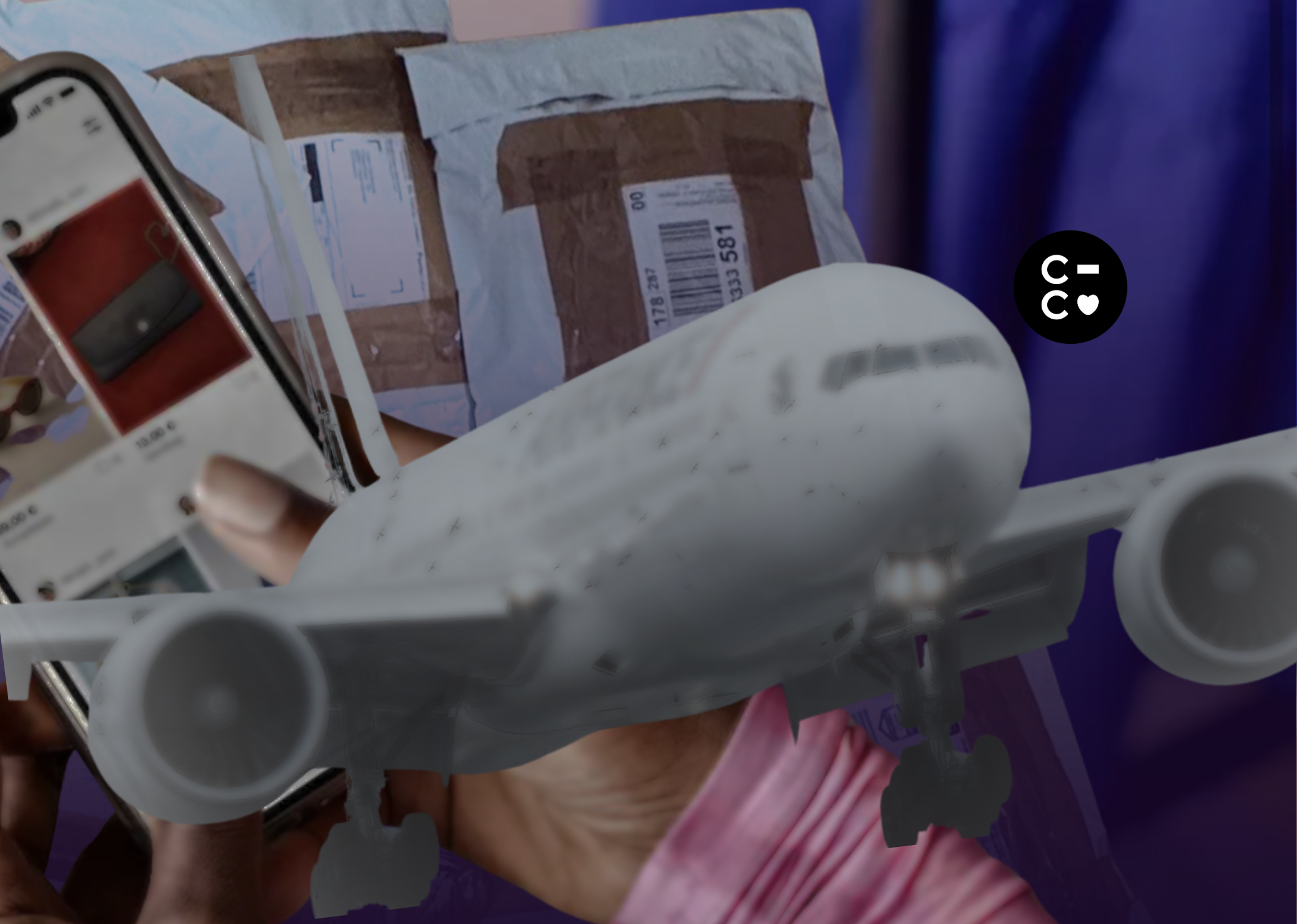ENTRETIEN
Pour Priscille-laëta Atteleyn, doctorante et chargée de cours au CELSA–Sorbonne (laboratoire GRIPIC), La Venelle, premier “village du réemploi solidaire”, illustre à la fois les ambitions et les paradoxes d’un réemploi institutionnalisé. Spécialiste des discours sur la mode circulaire, elle analyse, dans un entretien à CM-CM.fr, les ressorts sociaux et politiques de ce projet montreuillois.
Le réemploi s’expérimente à ciel ouvert rue de Saint-Antoine, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Inaugurée en septembre 2025, La Venelle rassemble une dizaine de structures, dont Emmaüs, La Collecterie, Neptune ou encore la Recyclerie Sportive du 93, réunies sur 1 800 m². Friperies, ateliers de réparation, café-cantine et potager urbain forment un ensemble hybride, entre commerce, insertion et convivialité.
Pensée comme un modèle d’économie circulaire locale, la Venelle est soutenue par la Ville de Montreuil et l’Agence de la transition écologique (ADEME). L’initiative nourrit de nombreux espoirs : créer des emplois, réduire les déchets, inscrire le réemploi au cœur de la ville. Mais elle met aussi en lumière les tensions d’une économie en mutation.
Un "village" du réemploi à Montreuil
CM-CM.fr – Vous avez récemment découvert La Venelle à Montreuil, qualifiée par ses porteurs de projet de village du réemploi solidaire. Que dit le mot “village” de la réalité du lieu ?
Priscille Atteleyn – Parler de “village” renvoie d’abord à l’idée d’un ensemble d’activités regroupées. Dans le retail, on retrouve ce type d’appellation dans les “villages outlet” ou certains flagships [boutiques conçues comme vitrines de l’image d’une marque], comme La Vallée Village ou le Village des Marques, où la diversité de biens de consommation rappelle le fonctionnement d’un centre commercial.
Mais ici, ce n’est pas cette composition marchande qui est mise en avant. Le mot “village” active un autre registre sémantique : celui du local et de la ruralité, associé à une consommation présentée comme plus “censée”, en opposition à une consommation urbaine jugée déconnectée des liens entre production et usage.
Le terme agit comme un label moral et un marqueur de distinction. Il suggère implicitement : “ici, vous consommez bien”.
Cette dimension morale - cette quête d’authenticité ou de “bon sens” - n’est pas seulement un discours : elle se traduit dans la matérialité du lieu. À La Venelle, les façades sobres, les matériaux réemployés, l’éclairage chaleureux et la signalétique épurée participent à une mise en sens de l’espace. Ces choix concrets véhiculent l’idée de proximité, de simplicité et de respect du territoire, tout en atténuant les hiérarchies marchandes.
Les dispositifs visuels et architecturaux “parlent” : ils suggèrent un lieu supposé plus éthique. L’acte d’achat s’y légitime implicitement : on ne se contente pas d’acheter, on entre dans un monde où l’objet, son histoire et les valeurs qu’il porte comptent davantage.
Il faut enfin souligner le paradoxe : appeler “village” une rue entière ou un pôle commercial traduit une tension entre mise en scène marchande et revendication de convivialité. C’est précisément ce type de tension – entre l’instrumentalisation d’un vocabulaire local ou rural et une véritable expérience sociale de proximité - qu’il est intéressant d’interroger.
L’enjeu pour l’analyse est de voir comment, au sein de ce dispositif concret, certains usagers perçoivent réellement ce lieu comme un vecteur de liens sociaux (arrêt spontané, discussions sur les bancs, ateliers collectifs) tandis que d’autres le ressentent plutôt comme une scénographie organisée.
Logique de "service", économie de fonctionnalité et de la coopération…

L’offre proposée mêle vêtements de seconde main, ateliers de réparation, potager et espaces de convivialité. Qu’est-ce qui vous a semblé le plus marquant dans cette combinaison d’usages et de services ?
P. A. – C’est cohérent : dans un village, qui est un véritable lieu de vie, les habitants se croisent et partagent une pluralité d’activités. La Venelle reproduit cette logique : on y achète, on y apprend, on y répare, on y mange, on y partage. L’idée est de construire une véritable galaxie d’usages qui compose un mode de consommation solidaire.
Ce projet est aussi pensé en fonction des publics, très divers, que l’on peut rassembler grâce à cette offre plurielle. L’enjeu dépasse la vente : il s’agit de créer des “moments” inscrits dans le calendrier du lieu faits de rencontres, d’événements, d’occasions de passage qui donnent un rythme collectif.
Ce n’est d’ailleurs plus surprenant, dans la conception contemporaine des espaces commerciaux, de voir apparaître cette logique de “service”. Elle s’inscrit dans l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC), qui privilégie l’usage plutôt que la possession. En France, ce modèle est soutenu par des politiques publiques et par des acteurs comme l’ADEME, la CRESS, ESS France ou Avise. Ils promeuvent des offres fondées sur le service, la mutualisation et l’accompagnement. La Venelle illustre parfaitement cette bascule.
Gentrification, distinction et vitrine de la seconde main
Selon vous, à quels besoins répond un lieu comme La Venelle : des besoins matériels concrets, ou plutôt des besoins symboliques et sociaux ?
En tant qu’habitante de Montreuil, habituée à fréquenter des lieux comme Neptune pour toutes sortes de besoins, j’ai été surprise par l’étroitesse de l’offre : peu de vêtements, peu de mobilier, peu d’électroménager. Cette limite s’explique sans doute par la jeunesse du projet, mais associée à des prix relativement élevés - notamment en comparaison à Emmaüs Solidarité, elle interroge.
Il existe donc aussi un risque de reproduction sociale : ces lieux attirent souvent des publics déjà sensibilisés, disposant d’un pouvoir d’achat raisonnable, pour qui la consommation éthique est un signe de distinction.Autrement dit, ces espaces peuvent participer à une forme de gentrification [processus par lequel des pratiques populaires sont investies et valorisées par des classes plus aisées]. Par cette revalorisation symbolique, on écarte parfois, malgré soi, le public que l’on cherchait à inclure.
Le potager, l’atelier, l’espace convivial composent une esthétique de transition, une “utopie réalisable” au sens de Friedman. Ils rassurent, attirent, fédèrent.
Cette mise en scène du commun peut aussi être instrumentalisée : elle sert parfois de vitrine, utilisée pour légitimer des politiques qui évitent les régulations contraignantes (taxes, quotas, limitations de volume) sur la production textile qui sont pourtant la seule réponse valable au désastre humain et écologique généré par l’industrie de l’habillement. L’espace se trouve alors pris entre sa fonction de service social et son rôle de vitrine, même à son corps défendant.
Ce danger est d’autant plus réel que l’investissement matériel nécessaire (locaux, équipements, formation, outils, coordination) et les contraintes de fonctionnement (horaires, fréquentation, ressources humaines) pèsent fortement sur ce qu’on peut proposer.
Si l’on avait voulu pousser plus loin la démarche, on aurait pu imaginer des formats hybrides : des ateliers itinérants dans les quartiers populaires, des permanences de réparation “minute”, des sessions en soirée ou week-end ou encourager la co-réparation (impliquer les usagers dans le geste technique). Mais pour rendre possible cette ambition, il faut des moyens, locaux bien équipés, du personnel formé ou rémunéré, pièces détachées, maintenance, gestion logistique, qui viennent aussi avec un double impératif de viabilité et de cohérence du projet.
Pour limiter ces écueils, une implication dès l’origine des collectifs de quartier et la mise en place d’instances représentatives réellement ouvertes sont essentielles : cela peut aider à maintenir le cap sur l’accessibilité, à anticiper les risques d’exclusion et à ajuster constamment les compromis entre ambition éthique et contraintes pragmatiques.
Circularité, capitalisme et réemploi dans “une économie existante”

Vous travaillez sur la critique de la circularité et ses ambiguïtés. La Venelle illustre-t-elle ces tensions entre affichage politique, enjeux économiques et réalités sociales ?
P. A. – La Venelle ne peut pas être analysée en dehors de son contexte : politique, social, géographique, économique. Ce type de projet mobilise de multiples acteurs et enjeux, et c’est précisément ce qui en fait un cas d’école. Son intérêt est réel : il propose des formes de consommation alternatives et ces expérimentations sont nécessaires si l’on veut amorcer des changements structurels dans nos modes de consommation.
Mais il faut avoir en tête les ambiguïtés qui traversent l’économie circulaire. Présentée comme une réponse aux défis environnementaux, elle est souvent pensée en termes d’optimisation des ressources et de réduction des déchets. Or, sa mise en œuvre soulève d’autres questions : l’inclusivité sociale, l’accessibilité économique et surtout la difficulté à faire émerger des modèles réellement dissidents par rapport à l’économie dominante.
C’est ce que je défends dans mes recherches : la circularité est traversée de tensions politiques et sociales. C’est sans doute ce qui explique mon ressenti, en arrivant à La Venelle : l’impression d’un lieu-vitrine. Derrière l’affichage politique et l’innovation sociale, on perçoit une tension constante entre projet alternatif et logiques économiques auxquelles il reste arrimé.
Vous évoquez dans vos recherches la “non-contrariété des volontés économiques en place”, autrement dit un réemploi qui ne remet pas en cause la surproduction. La Venelle en est-elle une illustration ?
P. A. – Oui, car la focale est placée sur les individus et leurs comportements de consommation, alors qu’il faudrait la déplacer pour comprendre comment ces initiatives s’inscrivent dans une économie capitaliste structurée par la recherche de rentabilité et de profit.
Dans ce cadre, les choix dissidents restent marginaux. Ils finissent souvent par être récupérés par ce qui est appelé le “capitalisme de la critique”, qui intègre et neutralise les contestations dont il fait l’objet.
Dans mes recherches, je montre aussi que les politiques liées à l’économie circulaire se concentrent surtout sur la recyclabilité des textiles. Cela invisibilise la surproduction, qui génère en amont les rebuts ensuite valorisés par ces projets. Autrement dit, on soigne les symptômes plutôt que d’attaquer la cause.
Plus largement, que nous dit cet exemple sur l’évolution du réemploi et de sa place en France aujourd’hui ?
P. A. – Si La Venelle avait remplacé une dizaine de magasins de neuf dans un quartier comme les Halles, j’aurais été davantage surprise. Ici, la “mise en danger” reste limitée.
L’intention est louable et loin de moi l’idée de vouloir portée atteinte à ce type de projet. Ces expérimentations sont précieuses : elles traduisent la volonté d’ancrer le réemploi dans le quotidien urbain.
Mais la mise en oeuvre se heurte à des contraintes sociales, économiques et structurelles fortes. Autrement dit, il s’agit moins de contester ces initiatives que d’en examiner les contraintes et les risques de détournement.
Même les initiatives les plus vertueuses peuvent, sans vigilance, être absorbées par ce “capitalisme de la critique”. Ces initiatives, une fois intégrées à ce système, transforment des pratiques alternatives en opportunités économiques, tout en maintenant les structures de consommation en place.
Il faut éviter toute naïveté : le réemploi et la circularité fonctionnent comme des industries à part entière, avec leurs flux de marchandises et leur besoin de renouvellement. Le réemploi s’inscrit lui aussi dans une économie existante, dominée par des logiques de rentabilité et de profit.
Propos recueillis par Maurane Nait Mazi
Catégorie : Pouvoir

→ 🖤 CM-CM.fr est le premier média d’information sur la seconde main. Vous pouvez vous abonner à la newsletter ici
Voir aussi : Shein au BHV : Culture Vintage claque la porte "pour pouvoir se regarder dans la glace"
Lire aussi : Girls of Vinted, "les salopes de Vinted"… : la face sombre de Vinted éclate en Europe
Pour aller plus loin : la sélection de Priscille-laëta Atteleyn
Jeanne Guien, Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants, Éditions Divergences, 2021. L’autrice analyse comment des objets banals du quotidien — dont les vitrines — matérialisent et médiatisent le consumérisme contemporain, révélant la dimension morale et esthétique de nos pratiques d’achat.
Luc Boltanski & Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 2000. Les auteurs montrent comment le capitalisme contemporain intègre et réactualise des critiques sociales, y compris l’utopie, pour légitimer ses nouvelles formes.
Philippe Moulévrier & Mathieu Hély, L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux pratiques, La Dispute, 2013. Les auteurs analysent comment les projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) se confrontent aux réalités sociales et économiques, naviguant entre idéalisme et pragmatisme.
Raphaël Llorca, L’imaginaire territorial des marques, étude pour l’Institut Terram / Fondation Jean-Jaurès, 2024. L’auteur analyse comment les marques contribuent à recomposer les représentations des territoires et à façonner des imaginaires localisés, entre communication et stratégie politique.
Robert Boyer, L’économie sociale et solidaire : une utopie réaliste pour le XXIᵉ siècle ?, Les Petits Matins, 2023. L’auteur plaide que l’économie sociale et solidaire (ESS) peut concilier efficacité, justice sociale et viabilité dans le monde contemporain.
Sophie Corbillé, « Les marques territoriales », Communication, OpenEdition Journals, 2013. L’autrice examine comment les territoires adoptent les logiques du branding pour construire une identité symbolique et concurrentielle, en articulant communication institutionnelle, attractivité économique et imaginaire collectif.
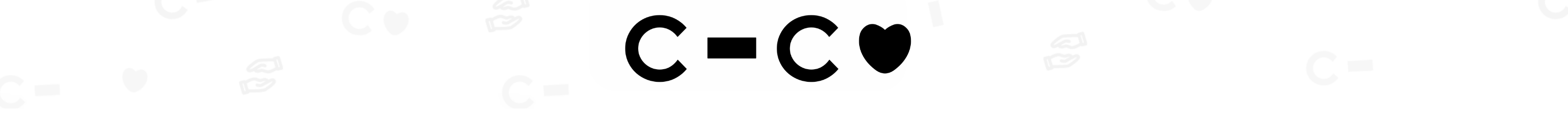


%20Roxane%20De%20Almeida%20(2).jpg)